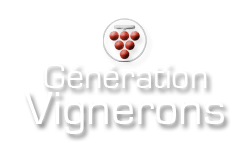Dans le cadre de l’Union européenne (UE), malgré une politique commune ancienne et qui bénéficie aujourd’hui de 32 % du budget européen, malgré des directives sur l’environnement ou le marché intérieur, l’agriculture ne fait pas l’objet de processus d’harmonisation fiscale. Or, les systèmes de taxation, objet de nos travaux récents, ne sont pas sans effet sur la rentabilité de l’agriculture, l’adoption de telle ou telle pratique plus ou moins respectueuse de l’environnement et l’artificialisation des terres de culture ou d’élevage.
Sur ce dernier point, l’UE, les gouvernements de nombreux États membres et la profession agricole sont unanimes : l’artificialisation des terres est rapide, particulièrement en France. C’est là un facteur d’érosion de la biodiversité voire de hausse des émissions de gaz à effet de serre avec l’étalement urbain.
Quelle solution pour freiner le phénomène ? Des travaux universitaires suggèrent deux pistes : renforcer la rentabilité de l’agriculture et des terres agricoles et augmenter le prix des terres. Or, la fiscalité influe sur ces trois facteurs. Si la taxation est trop élevée, elle peut diminuer la rentabilité de l’agriculture et donc faciliter l’urbanisation des terres agricoles. De même, le prix d’un actif correspondant en général à la somme actualisée de ses revenus futurs, si une forte taxation des terres agricoles diminue leur revenu annuel, cela tirera leur prix vers le bas et favorisera leur urbanisation.
En moyenne en Europe, les terres agricoles sont moins imposées que d’autres actifs, historiquement pour des raisons économiques et sociales plus qu’environnementales : soutenir la continuité de l’activité agricole et les revenus des exploitants, moderniser les exploitations. Toutefois, la France se trouve dans une situation particulière. Au sein de l’UE, elle est le pays qui taxe le plus fortement les terres agricoles.
Des taxes nettement plus élevées en France que dans le reste de l’UE
Outre plusieurs taxes liées au revenu (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, plus-values immobilières), la France applique, sur les terres agricoles, cinq taxes qui ne lui sont pas liées : la taxe foncière, la taxe pour frais de chambres d’agriculture, des droits sur les mutations à titre onéreux, des droits sur les mutations à titre gratuit et, le cas échéant, l’impôt sur la fortune immobilière.
La France fait partie de la moitié de pays européens qui conservent une taxe foncière indépendante du revenu sur les terres agricoles. Elle leur applique le taux marginal d’imposition le plus élevé en Europe au titre de l’impôt sur le revenu, le deuxième taux marginal le plus élevé pour les droits de mutation à titre gratuit, le quatrième taux le plus élevé pour les droits de mutation à titre onéreux et le cinquième taux le plus élevé pour les plus-values immobilières, avec des abattements très lents et la durée de taxation la plus longue. Elle est l’un des quatre seuls pays dans lesquels un impôt sur la fortune s’appliquant aux terres agricoles existe. Elle est le seul pays dans lequel cet impôt s’applique uniquement au foncier, désavantageant ainsi les terres agricoles par rapport aux valeurs mobilières ou liquidités.
En outre, alors que, dans plusieurs pays européens, la suppression récente de certains impôts a allégé la pression fiscale sur les terres agricoles, leur taxation a augmenté en France ces dernières années qu’il s’agisse des plus-values immobilières, des droits de mutation à titre onéreux, de l’impôt sur le revenu ou de plusieurs prélèvements sociaux.
Ces taxes multiples s’additionnent et leur total aboutit à une pression fiscale lourde et beaucoup plus élevée que dans les autres pays de l’UE sur les terres agricoles. Or, les propriétaires doivent les acquitter avec un revenu des terres agricoles particulièrement faible.
Des loyers fortement taxés et pourtant de plus en plus bas
La France se caractérise ainsi par un schéma devenu aujourd’hui contreproductif : un niveau de taxation élevé des terres agricoles et de leur revenu, une part importante de ces taxes qui est indépendante du revenu et qui ne tient pas compte du niveau très faible de ce revenu.
De fait, les loyers de fermage, fixés par l’État en France, y sont nettement plus faibles qu’en moyenne dans l’UE. Ils y représentent environ la moitié de ce qu’ils sont dans les pays voisins (en moyenne 140 euros par hectares en France contre 250 à 300 euros dans les pays voisins).
En comparant la taxation de deux personnes percevant le même revenu mais de deux sources différentes, on constate à quel point la situation des détenteurs de foncier rural est très défavorable. M. Dupont, propriétaire d’actions d’entreprises qui distribue un revenu libre et entier de 100 euros paye un impôt au taux fixe de 30 % et rien d’autre. Il lui reste 70 euros.
M. Durand, détenteur d’un terrain agricole, au lieu de percevoir un revenu complet de 100, ne recevra que 50 euros. Mais il payera, lui, chaque année, sur la moitié du revenu qui lui reste une taxe sur le foncier non bâti, une taxe pour chambre d’agriculture, un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont le taux marginal va jusqu’à 62,2 % et le cas échéant, un IFI. Bien que ne percevant que 50 % du revenu qu’il devrait percevoir, M. Durand est taxé comme s’il en avait perçu 100 %. La division par deux de son revenu, par l’État, n’est pas compensée par une taxation moindre. Au contraire, M. Durand est soumis à un taux global de taxation deux à trois fois plus élevé que M. Dupont qui, lui, perçoit 100 % de son revenu.
Ce système institué à partir de 1945 avait, à l’origine, vocation à permettre aux exploitants agricoles un accès à la terre sans supporter les coûts notables de son acquisition et à soutenir le revenu de ces derniers. Il s’agissait d’inciter des non-agriculteurs à « porter » le foncier agricole pour épargner cette charge aux exploitants et leur permettre d’investir dans la modernisation de leurs exploitations. En échange, les bailleurs se contentaient d’un loyer modeste, permettant un rendement bas mais positif.
Le dispositif, qui a correctement fonctionné jusqu’aux années 60, a déraillé, peu à peu, à partir des années 70 pour plusieurs raisons. D’abord, les loyers de fermage, peu revalorisés, ont augmenté moins vite que l’inflation. Depuis 1950, ils reculent d’environ 1,2 % à 1,3 % par an en euros constants. En parallèle, la taxation des revenus du foncier rural et des terres agricoles elles-mêmes s’est nettement accrue. On a donc assisté à un effet de ciseau : baisse des revenus et augmentation de la taxation.
Artificialiser, seule porte de sortie ?
Une telle combinaison aboutit tendanciellement à une rentabilité après impôt nulle voire négative des terres agricoles. Entre 1999 et 2019, le rendement locatif brut des terres agricoles a diminué de près de moitié.
En outre, le prix des terres agricoles qui avait progressé entre 1953 et 1978 a régressé après. À partir de cette date, l’appréciation du prix des terres n’a plus compensé l’érosion des loyers de fermage. Aujourd’hui, le prix réel moyen de l’hectare agricole est toujours inférieur de plus d’un tiers à sa valeur de 1978.
Les détenteurs de terres agricoles se sont donc trouvés placés dans une situation où, du fait de l’érosion puis de la disparition du rendement locatif net, la seule porte de sortie qui leur était laissée, pour tirer un revenu positif de leur actif, était d’en changer la destination : urbanisation, installation d’infrastructures d’énergies renouvelables.
Le mécanisme mis en place pour soutenir le revenu des agriculteurs aboutit donc, paradoxalement, à diminuer la quantité de leur premier facteur de production : la terre. Cette évolution n’est guère conforme à l’intérêt des exploitants agricoles qui sont peu nombreux à ne pas louer une partie au moins des terres qu’ils exploitent. Près des deux tiers des terres sont louées en France, contrairement au Royaume-Uni par exemple où la majorité des exploitants sont aussi propriétaires.
Elle semble par ailleurs contradictoire avec la maitrise de l’artificialisation aujourd’hui inscrite dans la loi et défavorable à la biodiversité et aux politiques climatiques. Les objectifs de zéro artificialisation nette en 2050 et de diminution du rythme d’artificialisation d’ici à 2030 ne règlent nullement ce problème. Les nouvelles normes règlementaires aboutiront probablement à diminuer la vitesse d’artificialisation des terres agricoles et des espaces naturels. On peut s’en réjouir. Mais ils ne modifient en rien la situation de rentabilité négative du foncier rural. Or, on voit mal comment les pouvoirs publics pourraient obliger les détenteurs d’espaces naturels et agricoles à conserver des actifs structurellement en perte. Si la règlementation n’évolue pas pour leur permettre d’atteindre une rentabilité minimale, même faible, leur artificialisation se poursuivra de manière déguisée. On le voit déjà avec la multiplication récente des projets d’installations photovoltaïques, très consommatrices d’espace et contraires à l’essence même du zéro artificialisation nette.
Guillaume Sainteny, Maitre de Conférences à AgroParisTech, Membre de l’Académie d’Agriculture de France, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.